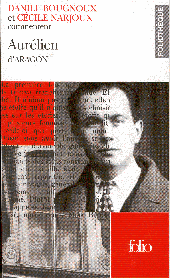
Consulter la table des matières
Lire l'introduction
Retour à la
page d'accueilDans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, Aragon tient à rappeler comment, au fil de son œuvre, il aura joué à démentir l’image où chaque titre allait l’enfermer, "chacun de mes livres contredisant le précédent, le parti-pris du précédent, mais rétablissant ainsi la continuité de tous ". Le charme si prenant et toujours sensible d’Aurélien, " roman de prédilection " aux yeux de son auteur comme pour ses nombreux lecteurs, tient sans doute à sa position centrale au sein d’une œuvre où il apporte à la fois rupture et continuité.
Dans les deux premiers romans du Monde réel, les seuls que les lecteurs pouvaient connaître à la fin de 1944, Aragon avait clairement tracé des perspectives de lutte, et répudié pour cela un surréalisme condamné rétrospectivement comme rêverie, et errance individualiste. Dans Les Cloches de Bâle (1934), l’ouvrier syndicaliste Victor sauve du suicide l’anarchiste Catherine et la réoriente, tandis que la grande figure historique de Clara Zetkin impose aux dernières pages l’illumination de la femme nouvelle, " celle que je chante (…) et que je chanterai ". Dans Les Beaux quartiers (1936), tandis qu’Edmond abandonne sa médecine pour côtoyer le crime et jouer les gigolos, son frère Armand rompt avec la bourgeoisie et se range au service de la classe ouvrière. Dans une postface ajoutée alors à ce roman, Aragon traçait une ligne de démarcation avec le monde ancien et avec " cette œuvre de nuages que je laisse derrière moi " ; il y déclarait sa solidarité avec ces " millions de Français qui réclament le Pain, la Paix, la Liberté ", dédiant Le Monde réel " à Elsa Triolet, à qui je dois d’être ce que je suis, à qui je dois d’avoir trouvé, du fond de mes nuages, l’entrée du monde réel où cela vaut la peine de vivre et de mourir " (ORC Pléiade 2, page 479).
Tout autre apparaît Aurélien, qui ne pouvait que déconcerter les lecteurs du Monde réel et les militants qui sortaient des épreuves de la guerre et de la Résistance. À l’automne de 1944, ce roman salué par des écrivains ou des critiques de droite comme Claudel ou André Rousseaux n’est pas bien accueilli par les propres camarades d’Aragon. Où l’auteur allait-il se perdre, à la suite de son héros si peu positif " errant dans Césarée " ? En quoi la rumination amoureuse et les atermoiements du cœur concernaient-ils les espoirs nés des luttes et de la Libération ? Tout se passe comme si, dans ce Paris des années 1922-1924 d’Aurélien si nostalgiquement ressuscité, Aragon renouait avec un passé honni. Mais c’est par là que ce roman rétablit la continuité : entre le surréalisme et le réalisme dans son œuvre, mais aussi avec les derniers romans, La Mise à mort (1965), Blanche ou l’oubli (1967) dont il annonce le travail de déconstruction. On peut voir en effet dans la déréalisation dont souffre l’ancien combattant, impuissant à ressaisir le temps, l’histoire ou sa propre parole dans le dialogue amoureux, une puissante interrogation d’Aragon sur les conditions mêmes du réalisme : que savons-nous du passage du temps, qui commande à l’Histoire, aux récits ou à ce sens intime de la durée dans laquelle chacun insère sa chétive existence ? Qu’embrassons-nous des êtres que nous disons aimer ? Qu’embrassons-nous de Paris, la ville-miroir ou la forêt des contes sillonnée en tous sens par les passants rêveurs qui s’y croisent et s’y perdent, et quelles pensées immobilisent ceux-ci aux bords de la Seine " charriant ses noyés " ?… En remontant aux conditions du désir, de la représentation ou de l’histoire, Aurélien approfondit singulièrement le projet du Monde réel, et prépare le vertige des dernières œuvres.
Mais ce roman où tous les autres viennent croiser et comme étoiler leurs branches se tient aussi en équilibre entre les genres : Claudel y lira un poème, et nous discuterons bien sûr cette poétique d’Aurélien sensible à bien des lecteurs ; on peut y suivre aussi le roman des autres arts, de la peinture d’abord puisqu’Aragon écrit cette histoire à Nice à la lumière d’Henri Matisse ; de la musique aussi, car il vient de renouer avec l’écriture poétique, et qu’il publie alors, légalement puis clandestinement, des vers qui composent un " chant national ". La peinture, la musique, la romance, les murmures de l’amour, le fracas de deux guerres et le silence assourdissant de la paix, le kaléidoscope d’une vie pleine de rencontres et d’éclats…, tout cela coule et se fond au creuset de cette histoire concassée, comprimée par la volonté de " faire le gris " et de sous-écrire pour mieux nous toucher à l’intime, et parler à chacun le langage de ses rêves.
Soixante années après sa parution, le roman d’Aurélien, bien loin d’avoir livré tous ses secrets, continue de rayonner et d’ouvrir des pistes critiques à l’inspiration de ses lecteurs. Tiraillé entre les tentations d’un imaginaire (mortifère) et les urgences de l’Histoire, ce récit tirerait-il sa force d’avoir été composé dans l’œil du cyclone ? Comme l’alcyon mentionné page 280, qui abrite sa maison de plume sur l’abîme de la mer, Aragon rêva Aurélien au cœur des pires circonstances ; la guerre y gronde, jusqu’au sein des couples, et son roulement se répercute d’un bord à l’autre du roman, mais celui-ci raconte non la guerre mais ses seules conséquences dans les consciences individuelles, apparemment lisses et tranquilles - un peu grises, comme la traître surface de la mer, aux profondeurs menaçantes.
ESSAI
I. Genèse d’Aurélien
Naissance
Le manuscrit
Réception
Réécriture
Les pilotis
Bérénice - Aurélien- Et Elsa ?
II. Motifs d’Aurélien
Le roman de la guerre
la brèche dans l’Histoire - la brèche dans l’identité - la brèche dans l’espace
Le roman de l’amour
l’impossibilité du couple - la pluralité de l’amour - l’imagination de l’amour - l’envers de la beauté - la jalousie
Le roman de Bérénice
plusieurs femmes distinctes - une absence - une présence - les yeux grands - le masque - le goût de l’absolu
Le roman d’Aurélien
l’antihéros - le fils - la mer
III. Poétique d’Aurélien
Flottements du temps
Anomalies - Parenthèse - Antique
Flottements de la personne
Polyphonie - Bariolage - Ironie
Théâtre
Distances - Représentations
Mentir-vrai
Mensonges - Légendes
Compositions
Peinture - Musique
Poème/Roman
DOSSIER
Retour au
haut de page