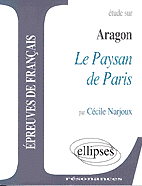
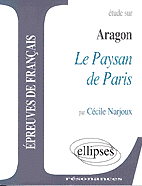
Consulter la table des matières
Lire l'introduction
Retour à la page d'accueil
On disait de celui qui ne pouvait s’empêcher de marcher qu’il était atteint de dromomanie. Ce fut le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui écrivit Les Rêveries du promeneur solitaire, ce fut sans doute le cas de bon nombre de ces écrivains pour lesquels mouvement et pensée, mouvement et écriture étaient indissociables et qui laissèrent ce que le narrateur du Paysan appelle " de simples promenades, mêlées de réflexions, comme il y en a plusieurs exemples dans la littérature " (p. 224). Ces " promenades mêlées de réflexion " inspirèrent certainement Aragon, marcheur invétéré, lorsqu’il choisit lui aussi d’écrire ses Tableaux parisiens et ses Nuits de Paris. Le Paysan de Paris s’inscrit d’abord dans un champ littéraire qui remonte au XVIIIème siècle, mais il s’agit pour lui non tant de l’honorer que de le subvertir. Nous sommes en effet au temps du Surréalisme, et l’esprit de Dada souffle encore dans le Passage de l’Opéra. A la même époque, Breton écrit Nadja, autre histoire d’une promenade, autre histoire d’une rencontre. Notre Paysan erre plus qu’il ne se promène, mais délibérément, et il fait non pas une mais des rencontres, toutes surprenantes, toutes merveilleuses et fantastiques à la fois, autant de passantes fugitives et baudelairiennes, qui lui donnent le goût de l’éphémère autant que de l’absolu. Et si sa déambulation géographique, spirituelle et scripturale de l’autre côté de " la porte du mystère " (p. 20) s’achève sur un profond désespoir devant ce qu’il ne perçoit plus in fine que comme des " abstractions vides " (p. 239), cet étonnant guide d’un autre Paris qu’est le paysan- narrateur, où il fait surgir pour ses lecteurs mille " divinités poétiques " (p. 19), a certainement voulu que nous ne restions pas ces " malades lecteurs " que rien ne pouvait " tirer de l’ennui " (p. 224). Suivons le donc, et laissons nous prendre à ses paroles auxquelles il a entrepris de " mêler le paysage " : " joignant l’exemple à la réflexion, j’ai proposé une voie au frisson " (p. 225), dit-il.
Introduction
Repères biographiques
L'OEUVRE ET SES CONTEXTES
I. Le contexte littéraire
II. Le contexte personnel
III. Genèse et prépublications
IV. Place et influence du Paysan de Paris dans l’œuvre
d’Aragon
CLES POUR L’ŒUVRE
I. Structure du Paysan de Paris
1. Préface à une mythologie moderne (p. 9-16)
2. Le Passage de l’Opéra (p. 19-136)
3. Le Sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont (p. 139-230)
4. Le Songe du Paysan
II. Figures essentielles
1. Je et Tu : les instances de l’énonciation
2. Les propos rapportés
3. L’idée du Merveilleux : objet du discours et objet de la
quête
L'ŒUVRE EN EXAMEN
I. Perspective thématique
1. La lumière et le regard
2. Le désir, l’érotisme et les femmes
3. Le mythe et la modernité
4. Les passages, les métamorphoses et la déambulation
5. L’écriture
II. Perspective philosophique
1. De Platon à Descartes : contre le rationalisme
2. De Kant à Hegel : pour l’idéalisme
3. De Schelling à Freud : l’inconscient
III. Perspective poétique
1. L’hétérogénéité des formes
2. les jeux typographiques
3. les collages visuels
4. les collages textuels ou l’intertextualité
5. La discontinuité
III. la pluralité des formes du discours
1. le réalisme descriptif
2. le procédé de l’écriture automatique
3. le lyrisme
4. le fantastique et le surréel
5. l’ironie
IV. L’ambivalence générique
1. une autobiographie ?
2. un roman ?
3. un poème ?
4. Analyse du titre
L'OEUVRE AUX EXAMENS
1. Dissertation littéraire
2. Autres sujets de dissertation
3. Etude de texte : lecture linéaire
4. Nouvelles épreuves écrites du français au baccalauréat
Guide du lecteur
Glossaire
Bibliographie
Retour au haut de page